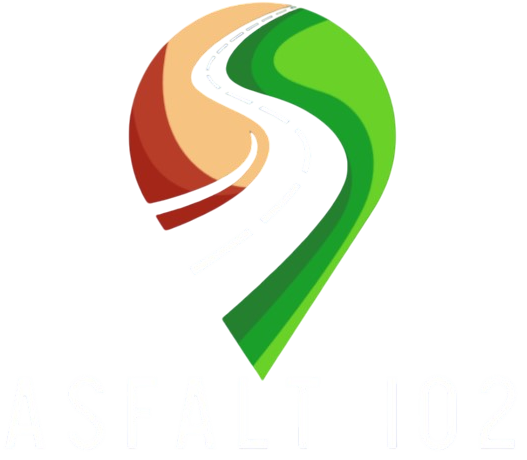le repérage Amiante (Avant Travaux) sur enrobés
Cette obligation transposée dans le Code du Travail résulte du décret 2017-899. elle est encadrée entre autres par l’application de la norme NFX46-102 et son arrêté d’application du 4 juin 2024. La norme définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des repérages amiante avant tous travaux sur voirie et précise notamment le rôle des différents acteurs concernés ainsi que les éléments mentionnés dans les rapports de repérage.
la caractérisation des enrobés
C’est un processus essentiel pour évaluer leur qualité, leur performance et leur impact environnemental, qui ne relève pas du paragraphe précédent (la caractérisation n’est pas imposée dans la réalisation d’un repérage amiante avant travaux réglementaire). Voici les principaux aspects à considérer :
1. Caractéristiques des enrobés
- **Composition **: Les enrobés sont constitués de granulats (sables, graviers, etc.) et d’un liant bitumineux. La nature et la proportion de ces composants influencent les propriétés de l’enrobé.
- **Propriétés mécaniques **: Elles déterminent la résistance de l’enrobé aux charges, à la déformation et à la fatigue. On mesure notamment la rigidité, la résistance à la traction et la durabilité.
- **Propriétés environnementales **: Elles concernent l’impact de l’enrobé sur l’environnement, notamment la présence de substances dangereuses (amiante, HAP) et la possibilité de recycler les matériaux.
2. Méthodes de caractérisation
- **Essais en laboratoire **: Ils permettent de mesurer les propriétés mécaniques, physiques et chimiques des enrobés. On utilise des équipements spécifiques pour déterminer la granulométrie, la teneur en liant, la compressibilité, etc.
- **Essais in situ **: Ils sont réalisés directement sur les chaussées pour évaluer l’état de l’enrobé, sa portance et sa résistance au trafic. On utilise des méthodes telles que le carottage, la pénétrométrie et la deflectométrie.
- **Analyses environnementales **: Elles visent à détecter la présence de substances dangereuses dans les enrobés, notamment l’amiante et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Des prélèvements sont effectués et analysés en laboratoire.
3. Normes et réglementations
- **Normes **: Elles définissent les exigences de qualité pour les enrobés, les méthodes d’essai et les critères d’acceptation. Les normes européennes (EN) sont souvent utilisées comme référence.
- **Réglementations **: Elles encadrent l’utilisation des enrobés, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et la sécurité des travailleurs. Elles peuvent varier en fonction des pays et des régions.
4. Importance de la caractérisation
- **Qualité des chaussées **: La caractérisation permet de s’assurer que les enrobés utilisés sont adaptés aux conditions de trafic et climatiques, garantissant ainsi la durabilité et la sécurité des chaussées.
- **Maintenance **: Elle aide à identifier les problèmes (orniérage, fissures, etc.) et à choisir les techniques de réparation appropriées.
- **Environnement **: Elle permet de contrôler la présence de substances dangereuses et de favoriser le recyclage des matériaux.
Parmi les méthodes de caractérisation des enrobés :
- Essais mécaniques : Ils permettent de déterminer la résistance à la compression, à la traction, au cisaillement et à la fatigue des enrobés. Ces essais sont réalisés en laboratoire sur des échantillons d’enrobés.
- Essais physiques : Ils permettent de déterminer la densité, la porosité, la perméabilité et la texture des enrobés. Ces essais sont également réalisés en laboratoire sur des échantillons d’enrobés. Voici quelques exemples d’essais physiques couramment réalisés sur les enrobés :
- Essai de densité : Cet essai permet de déterminer la masse volumique de l’enrobé. La densité est un paramètre important pour la qualité de l’enrobé et sa résistance à la fatigue.
- Essai de porosité : Cet essai permet de déterminer le volume des vides présents dans l’enrobé. La porosité influe sur la perméabilité de l’enrobé et sa résistance au gel.
- Essai de perméabilité : Cet essai permet de mesurer la capacité de l’enrobé à laisser passer l’eau. La perméabilité est un paramètre important pour le drainage de la chaussée et la sécurité des usagers.
- Essai de texture : Cet essai permet de déterminer la rugosité de la surface de l’enrobé. La texture influe sur l’adhérence des pneumatiques et la sécurité des usagers.
En plus de ces essais, il est également possible de réaliser d’autres essais physiques sur les enrobés, tels que :- Essai de dureté : Cet essai permet de mesurer la résistance de l’enrobé à la pénétration d’un objet dur.
- Essai de cohésion : Cet essai permet de mesurer la force nécessaire pour séparer les particules de l’enrobé.
- Essai de fluage : Cet essai permet de mesurer la déformation de l’enrobé sous l’effet d’une charge constante.
- Les résultats de ces essais physiques sont importants pour :
- Choisir le type d’enrobé adapté à l’utilisation prévue.
- Contrôler la qualité des enrobés.
- S’assurer de la durabilité des enrobés.
- Prévenir les risques de pathologies.
- Essais chimiques : Ils permettent de déterminer la composition chimique des enrobés, notamment la teneur en bitume, en granulats et en fillers. Ces essais sont réalisés en laboratoire par des chimistes spécialisés.
Les essais in situ permettent de mesurer la portance, l’uni et la texture des enrobés. La caractérisation des enrobés est importante pour :
- Choisir le type d’enrobé adapté à l’utilisation prévue.
- Contrôler la qualité des enrobés.
- S’assurer de la durabilité des enrobés.
- Prévenir les risques de pathologies.
En conclusion, la caractérisation des enrobés est une étape essentielle pour garantir la qualité, la durabilité des chaussées, la performance et la sécurité des chaussées, tout en protégeant l’environnement.
Quelques définitions…
Le filler est un composant essentiel des enrobés bitumineux. Il s’agit d’une poudre très fine, généralement minérale, dont les particules ont une taille inférieure à 63 micromètres.
Rôle du filler dans les enrobés, il joue plusieurs rôles importants dans les enrobés:
- Amélioration de la cohésion: Le filler, en se mélangeant au bitume, forme un mastic qui améliore la cohésion entre les granulats. Il permet de mieux lier les différents composants de l’enrobé, ce qui contribue à sa résistance mécanique.
- Augmentation de la compacité: Les particules fines du filler comblent les espaces entre les granulats, ce qui augmente la compacité de l’enrobé. Une meilleure compacité améliore la durabilité et la résistance à la fatigue de l’enrobé.
- Stabilisation du bitume: Le filler interagit avec le bitume et modifie ses propriétés rhéologiques. Il contribue à stabiliser le bitume en réduisant sa sensibilité aux variations de température, ce qui améliore la performance de l’enrobé dans différentes conditions climatiques.
- Amélioration de l’imperméabilité: En remplissant les vides entre les granulats, le filler réduit la perméabilité de l’enrobé, ce qui limite l’infiltration d’eau et protège la structure de la chaussée.
Il existe différents types de fillers, principalement d’origine minérale :
- Calcaire: C’est le filler le plus couramment utilisé. Il est issu du broyage de roches calcaires.
- Siliceux: Ce filler est issu du broyage de roches siliceuses. Il est plus résistant à l’usure que le filler calcaire.
- Pouzzolane: Ce filler est d’origine volcanique. Il possède des propriétés hydrauliques qui peuvent améliorer la résistance de l’enrobé.
- Laitier de haut fourneau: Ce filler est un sous-produit de l’industrie sidérurgique. Il possède des propriétés liantes qui peuvent renforcer l’enrobé.
- L’ajout de chrysotile (une forme d’amiante) dans le filler des enrobés a été pratiqué par le passé, Jusqu’au début des années 1990, l’amiante chrysotile était parfois ajouté aux enrobés routiers, principalement dans les couches de roulement, à une concentration d’environ 1% de la masse sèche. L’objectif était d’améliorer certaines propriétés des enrobés, telles que la résistance à la fatigue et la durabilité. L’ajout de chrysotile dans le filler des enrobés a été une pratique révolue en raison des risques sanitaires liés à l’amiante. Des alternatives plus sûres et performantes sont désormais utilisées pour améliorer les propriétés des enrobés.
Le choix du type de filler dépend de plusieurs facteurs, tels que le type d’enrobé, les conditions climatiques, le trafic et les exigences de performance.
En conclusion, le filler est un composant essentiel des enrobés bitumineux qui contribue à améliorer leurs propriétés mécaniques, leur durabilité et leur performance.
nota : Il est important de noter que la présence d’amiante dans d’anciens enrobés peut poser des problèmes lors de travaux de réfection ou de démolition de chaussées. Des mesures de sécurité spécifiques doivent être prises pour protéger les travailleurs et l’environnement, en commençant par l’obligation de faire réaliser un repérage amiante avant travaux sur les enrobés concernés par l’emprise des travaux.