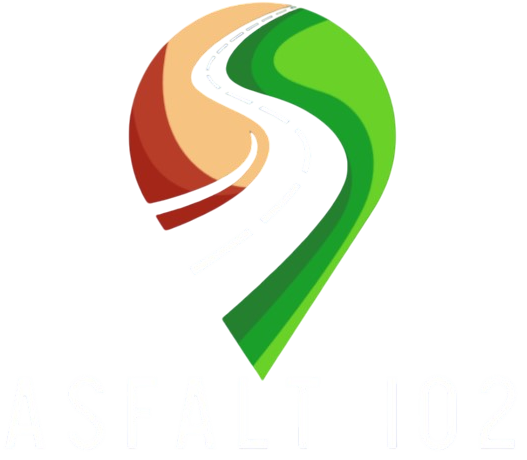contrairement aux obligations réglementaires de Repérages Avant Travaux relatives à l’Amiante (RAAT), bien que ne relevant d’aucune obligation réglementaire identique, les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycyliques) pose une réelle problématique lors du recyclage ou de la gestion des déchets à l’issue de travaux sur des enrobés bitumineux.
d’après le CEREMA « L’ensemble du réseau routier français (1 000 000 km) représente potentiellement un gisement de plusieurs milliards de tonnes d’agrégats d’enrobés issus du fraisage ou de la démolition d’enrobés bitumineux. Dans un contexte d’économie circulaire fort, ces agrégats d’enrobés, considérés comme des déchets routiers, recèlent un potentiel de propriétés techniques qu’il est important de valoriser tout en respectant des exigences technologiques, mécaniques, environnementale et de santé publique (protection des travailleurs).«
Gestion des déchets
Les agrégats d’enrobés sont soumis à la réglementation sur la gestion des déchets et doivent faire l’objet d’analyses préalables en laboratoires accrédités afin de savoir s’ils contiennent des substances dangereuses tels que le goudron. Ce goudron de houille, utilisé jadis en construction routière comme liant hydrocarbonné, contient de fortes teneurs en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). Certains HAP sont classés officiellement par le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC) comme cancérogènes avérés pour l’homme. C’est pourquoi, il est important de rechercher la présence de ces polluants contenus dans le déchet routier afin d’en déterminer la concentration et orienter au mieux le déchet vers des filières de stockage ou de valorisation adaptée (ré-emploi, recyclage..).
Les HAP étudiés font partis de la liste de 16 HAP considérés par l’agence de la protection de l’environnement des Etat-Unis (US EPA) comme étant les plus toxiques. On peut également évoquer les HCT (Hydrocarbures Totaux), ils peuvent être d’origine naturelle ou synthétique. Ils peuvent être un indicateur d’une pollution anthropique et présenter une certaine toxicité pour l’écosystème et l’homme. Leur quantification portent sur la fraction C10 – C40 et C10-C21.
A noter que le goudron est interdit sur les routes depuis 1993, mais on l’emploie encore pour le revêtement de certaines surfaces nécessitant une résistance aux hydrocarbures (stations essence, péages d’autoroutes, etc.). Le goudron était associé au bitume utilisé comme liant dans les enrobés.
Le bitume est composé d’un mélange d’hydrocarbures que l’on trouve à l’état naturel, mais qui provient le plus souvent de la distillation de pétrole. Contrairement au bitume, le goudron ne provient pas du pétrole mais de la pyrolyse de la houille (c’est un sous-produit de la transformation de la houille en coke). Il n’existe donc pas à l’état naturel. Le goudron a été largement employé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, d’abord pour la préservation du bois des bateaux et le calfatage des coques, puis comme liant pour le revêtement routier. Il a été progressivement abandonné au profit du bitume du fait de sa dangerosité (classé cancérogène) et de son mauvais vieillissement.
Enfin, l’asphalte peut désigner deux matériaux différents : un liant artificiel constitué de granulats fins, de poudres minérales (fillers) et de bitume (entre 7 % et 14 %). Il contient parfois de l’asphalte naturel, d’où son nom. Chauffé à 200 °C, il est employé pour le revêtement des trottoirs, parkings, stations de métro ou de toute surface ne nécessitant pas une forte résistance mécanique et une roche silico-calcaire imprégnée de bitume, appelée aussi asphalte naturel.
Différents seuils ont été fixés pour définir le « devenir » de ces déchets d’enrobés
- Le seuil d’acceptabilité pour l’analyse en HAP est de 50 mg/Kg de déchet sec = Déchet Inerte et Réutilisable (recyclage à chaud admis).
- Entre 50 mg/kg et 500 mg/kg, les enrobés peuvent être recyclés à froid ou déposés en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
- Au-delà, de 500 mg/kg, les enrobés ne peuvent pas être recyclés et devront être orientés vers des ISDND.
- Quand le taux de HAP est supérieur à 1000 mg/kg, le matériau est alors considéré comme Déchet Dangereux (ISDD).
concernant les HCT :
- jusqu’à 300 mg/kg = Déchets Inertes (ISDI) et recyclables à froid et à chaud.
- entre 300 et 500 mg/kg = Déchets Inertes (ISDI) et non recyclables.
- au delà de 500 mg/kg = Déchet Dangereux (ISDD).
et le transport des déchets?
Les déchets d’enrobés bitumineux contenant des HAP (> 50 mg/Kg) ne sont pas des matières dangereuses au sens de la réglementation transport ADR.
Cependant, ceux-ci sont des déchets dangereux au sens du code de l’environnement; ils doivent donc être traités dans des installations dédiées(installations de stockage de déchets dangereux); au préalable, le donneur d’ordres (ou l’entreprise par délégation) doit s’assurer des conditions d’acceptation de ces déchets (emballage, quantité, etc…) par l’installation de stockage en lui demandant un certificat d’acceptation préalable (CAP).
les HAP et la santé? l’environnement?
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des produits de la combustion incomplète de matériaux comme le charbon, le pétrole, le gaz, le bois, la consumation d’une cigarette (tabac) et la viande grillées au charbon de bois. Ces produits sont un polluant atmosphérique commun qui contamine fréquemment les cultures.
La structure moléculaire de certains types de HAP les amène à être transformés dans l’organisme en composés extrêmement toxiques, appelés époxydes. Les époxydes réagissent très facilement avec l’ADN, ce qui peut entraîner des mutations génétiques menant parfois au cancer.
Comme on intègre des suies dans les produits en caoutchouc afin d’en améliorer l’élasticité et les propriétés d’amortissement, on trouve aussi des HAP dans les
poignées en caoutchouc de certains outils ou encore dans les gaines de fils électriques. On les retrouve aussi en quantité non négligeable dans les aliments qui ont subi une étape de combustion : produits céréaliers ou huiles végétales traités, viandes et poissons fumés ou grillés.
Les HAP sont relativement peu volatiles et peu solubles dans l’eau. Ils ne s’évaporent donc pas aisément des matériaux qui les contiennent, mais parviennent le plus souvent dans l’environnement, liés aux particules issues de l’usure de ces matériaux.
L’homme peut les assimiler par trois voies de pénétration dans l’organisme et sources d’exposition :
- par voie orale, en ingérant des aliments qui contiennent des HAP ;
- par voie respiratoire, en respirant des poussières qui en contiennent,
- par voie cutanée, en touchant des matériaux qui en contiennent.
Par expérience, il est recommandé aux diagnostiqueurs qui souhaitent réaliser des RAAT sur les enrobés (entre autres) et qui sont donc amenés à manipuler régulièrement des échantillons d’enrobés de porter des gants de protection adaptés aux hydrocarbures. La peau peut absorber des HAP lorsqu’elle se trouve en contact direct avec des produits contenant des poussières de HAP, ou au contact de matériaux en contenant.
Les HAP que l’on respire proviennent principalement de la fumée du tabac. Une personne fumant 20 cigarettes/jour absorbe en moyenne 105 ng/jour de benzo(a)pyrène et un fumeur passif 40 ng/jour considérant une exposition de 5 heures (EFSA, 2008). Les poêles ayant un mauvais tirage peuvent aussi augmenter le taux de HAP d’une pièce. Les gaines de câbles et la colle des vieux parquets peuvent dégager de faibles quantités de HAP.
A l’extérieur, les HAP proviennent essentiellement des gaz d’échappement (principalement les diesels) et, dans une moindre mesure, des chauffages et de l’abrasion des pneus. De même, les granulés des gazons synthétiques, fabriqués à partir de pneus usagés, dégagent de très faibles quantités de HAP sur les terrains de sport.
Les risques associés à ces composés sont principalement liés à une exposition chronique car les HAP présentent des concentrations dans l’environnement relativement faibles. Les HAP forment des dépôts sur les végétaux et contaminent aussi les eaux de surface. Ils peuvent s’accumuler dans la faune et la flore.
à noter qu’on ne retrouve pas des HAP QUE dans les enrobés…
Sans sombrer dans le conspirationnisme, depuis de nombreuses années, des granulés de pneus sont utilisés en tant que matériaux de remplissage pour des terrains de sports et aires de jeux synthétiques. Ces matériaux suscitent des préoccupations quant à leur éventuel impact sur la santé et l’environnement. L’Anses a analysé les études et expertises disponibles sur le sujet ainsi que les dernières les évolutions réglementaires. Le point sur le sujet.
Le recyclage de pneus usagés, sous forme de granulés pour la production de sols et revêtements synthétiques, représente l’une des principales voies de valorisation des déchets de ces produits.
La réglementation européenne impose depuis 2022 une limite de concentration de 20 mg/kg pour la somme de 8 substances HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dans les granulés non liés utilisés comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique, les aires de jeux ou pour des applications sportives. Ainsi l’Anses recommande de poursuivre l’analyse des substances présentes dans les granulés liés utilisés afin de préciser la composition des produits et articles commercialisés. Elle préconise également d’effectuer des mesures pour déterminer la composition de l’air intérieur des bâtiments dans lesquels des terrains synthétiques solides – intégrant des granulés liés – sont installés.
La littérature d’information est prolixe sur le sujet en relatant les orientations des choix de nombreuses communes françaises sur le sujet… Il appartient à chacun de la consulter librement selon ses convictions et sources d’intérêts.